Sujet d’actualité, de santé ou sociétal, je vous partage mes prises de position pour vous faire découvrir ma vision de notre société qui bouge, s’investit et innove sur l’ensemble du territoire.
Assurance, Soins et accompagnement, Logement, Santé, ESS, retrouvez l’ensemble de mes prises de paroles.
Mes actualités Stéphane Junique
VYV les idées solidaires
11/04/2024
Public Sénat : 30′ face à la presse
Le 5 avril dernier, j’ai eu le plaisir d’être invité de l’émission hebdomadaire d’interview politique « Extra local » diffusée par la chaîne Public Sénat....
VYV les idées solidaires
27/03/2024
Construire une sécurité sociale alimentaire pour les Français
Pour démultiplier notre capacité d’action nous avons, avec Youssef Achour, président de la coopérative UpCoop et du groupe Up, signé un partenariat pour faire accélérer...

VYV les idées solidaires
22/03/2024
Bâtir une diplomatie de l’économie sociale et solidaire
Dans le cadre de sa campagne pour la présidence d'ESS France, Stéphane Junique répondait aux questions du magazine Carenews avec Camille Dorival. Une belle tribune pour...

VYV les idées solidaires
21/03/2024
« Je plaide pour un Parlement de l’ESS »
Stéphane Junique était invité par Mediatico dans "ESS On Air", l’émission qui traite l’actualité au travers de l’économie sociale et solidaire. L'occasion d'exposer sa...
Mon parcours
Stéphane Junique, militant de la santé et de la solidarité, né en 1973.
Président du Groupe VYV et de VYV 3, l’offre de soins et d’accompagnement du Groupe VYV
Vice-président de la Mutualité Française (FNMF).
Les débuts d’une passion pour la médecine d’urgence…
L’événement à l’origine de mes engagements est le tremblement de terre à Mexico survenu en septembre 1985. Le séisme avait ravagé la ville, qui s’était effondrée comme un jeu de quilles, causant plus de dix mille morts et trente mille blessés. Comme beaucoup de personnes, j’avais été frappé par cette tragédie et ému par la mobilisation des centaines de sauveteurs français qui avaient rejoint les équipes mexicaines pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres. Au-delà des images insoutenables diffusées par les journaux télévisés, c’est bien l’action de ces médecins, infirmiers, sapeurs-pompiers et secouristes bénévoles – qui avaient pour mission de ramener à la vie, de retenir la vie – qui m’a donné la passion de la médecine d’urgence et la volonté de m’engager.
C’est ainsi qu’à l’âge de 13 ans je suis devenu bénévole à la Protection civile puis à la Croix-Rouge française de Valence, où je me suis engagé dans des missions de secours et d’urgence. Et c’est à l’occasion de ces heures passées en poste de secours et en permanence de nuit avec les équipes du Samu que mon désir de devenir infirmier s’est forgé. Mes échanges avec le Pr Pierre Huguenard, patron du Samu de Créteil, l’un des précurseurs et fondateurs de la médecine d’urgence, le Pr Geneviève Barrier, directrice du Samu de Paris, et le Dr Suzanne Tartière, médecin régulateur au Samu de Paris, ont été déterminants dans la construction de mon parcours professionnel.
Ma bibliographie
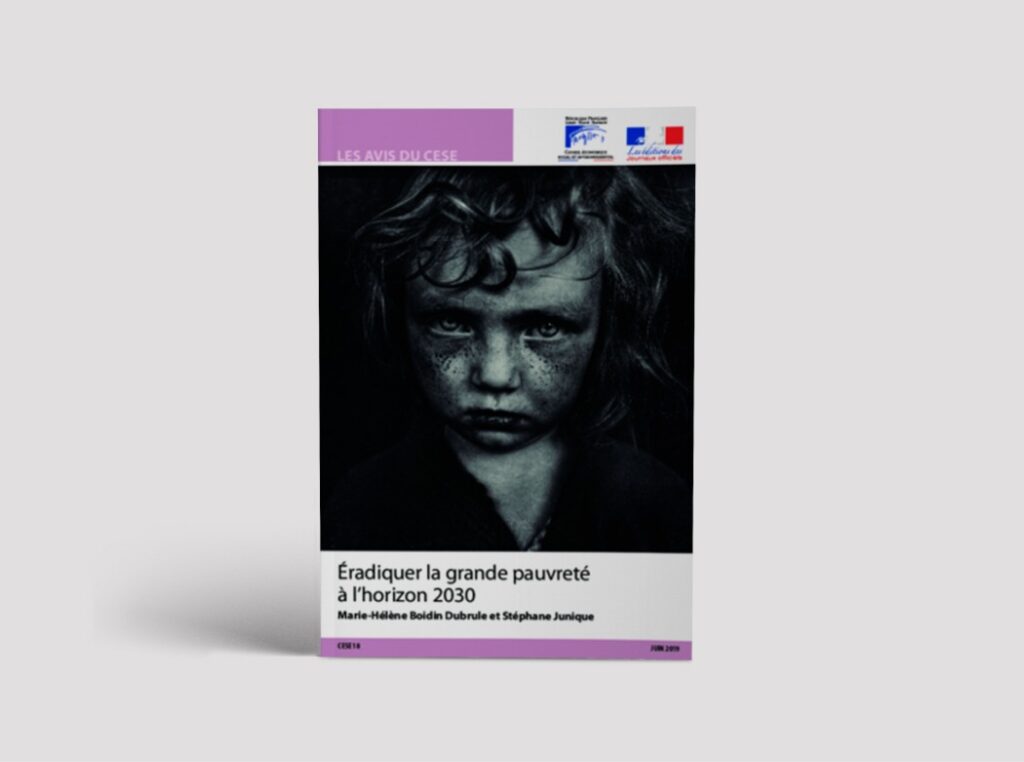
Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030
Conseil économique social et environnemental · 26 juin 2019
Co-rapporteur, aux côtés de Marie-Hélène Boidin Dubrule, du rapport « Éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030 », pour la commission temporaire « Grande Pauvreté » du CESE.
Après avoir remis, en décembre 2018, un avis portant sur « la situation des personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir », Stéphane Junique a présenté en juin 2019, un rapport sur l’éradication de la grande pauvreté à l’horizon 2030.
La France s’est engagée, en adoptant les objectifs de développement durable établis par l’ONU, à éradiquer la grande pauvreté à l’horizon 2030. Cet objectif est ambitieux : 5 millions de personnes sont concernées dans notre pays. Pourtant, le CESE estime qu’il est à la fois nécessaire et possible de l’atteindre, par la mobilisation de toutes et tous. Après un premier avis rendu en décembre 2018, intitulé « Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir », le CESE s’engage, en soutenant la création d’un revenu minimum social garanti, en posant un cadre et des principes d’action, en réclamant un meilleur accès aux droits et un accompagnement renforcé, pour l’éradication de la grande pauvreté en 2030. Si ces préconisations visent d’abord cet objectif, il a la conviction que chaque pas dans cette direction servira à faire reculer la pauvreté en général.
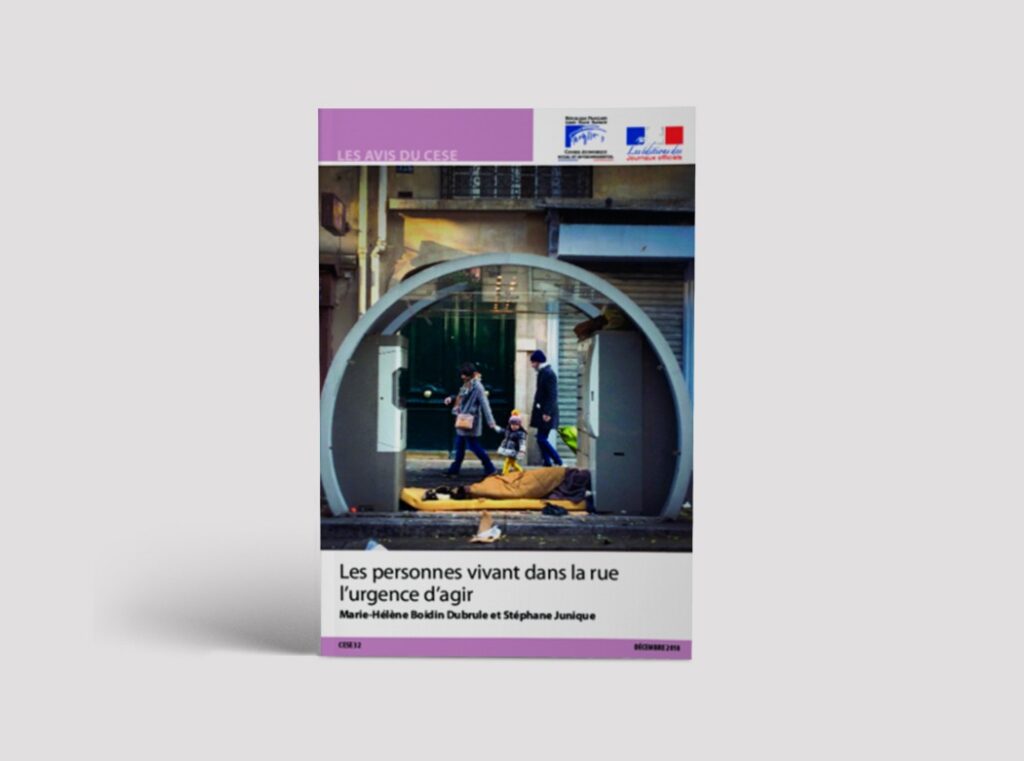
Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir
Conseil économique, social et environnemental · 12 déc. 2018
Co-rapporteur, aux côtés de Marie-Hélène Boidin Dubrule, de l’avis « Les personnes vivant dans la rue : l’urgence d’agir » pour la commission temporaire « Grande Pauvreté » du CESE.
Des centaines de milliers de Françaises et de Français ont apporté ces derniers mois leurs signatures à des pétitions en ligne réclamant des solutions pour les personnes sans-domicile fixe. Le CESE, déjà engagé dans un travail sur la grande pauvreté, a voulu tenter de répondre à cette émotion et à cette indignation en proposant sa vision de la lutte contre cette forme extrême d’exclusion.
Si les préconisations de l’avis portent d’abord sur le logement, c’est que celui-ci est la clef de l’accès à une vie décente. Elles visent ensuite l’amélioration du traitement de l’urgence. Enfin, elles portent sur les différentes dimensions de l’accompagnement, qu’il soit relationnel, qu’il permette l’accès aux droits ou aux soins ou facilite le retour à la vie sociale. « Zéro personne sans accompagnement » est le but vers lequel doit tendre toute la société.

L’Égalité (im)possible ? Manifeste pour une solidarité active
Les Petits Matins · 31 mai 2018
Stéphane Junique est co-auteur de L’égalité (im)possible? avec Timothée Duverger, un manifeste pour une solidarité active.
Cet ouvrage a été publié en mai 2018 et a reçu en septembre 2019 le prix du livre sur l’économie sociale et solidaire.
Prix du livre sur l’économie sociale et solidaire 2019
Oui, nous pouvons vivre mieux – tous ! Voilà un propos à contre-courant du discours ambiant quand il est question de santé ou de protection sociale. Les inégalités sociales et territoriales se creusent, le déficit de l’Assurance maladie persiste, le modèle de solidarité collective hérité de 1945 s’essouffle… Tout cela est vrai. Devons-nous pour autant nous résoudre à voir s’installer un système de protection à deux vitesses ?
Non, affirment ici deux acteurs engagés : un militant mutualiste de longue date et un chercheur spécialiste de la question sociale, qui défendent une approche non lucrative de la santé – la santé envisagée dans une acception large, car on ne saurait être bien dans son corps et dans sa vie sans un logement digne, un revenu décent, un égal accès à l’éducation et aux loisirs…
Leur constat : face aux transformations de la société (carrières discontinues, vieillissement de la population, explosion des maladies chroniques, etc.), l’État ne peut plus tout. Leur solution : constituer un « pôle des solidarités actives ». Une alliance pour et par l’action des structures historiques de l’économie sociale et solidaire et de nouvelles entités tournées vers l’intérêt général.
Nourrissant leur échange de nombreux exemples et de propositions (une politique de santé réorientée vers la prévention, un socle de droits universels garantis, une reconnaissance européenne des modèles alternatifs, etc.), les auteurs dessinent une société plus juste et désirable. Une société d’égalité possible.












